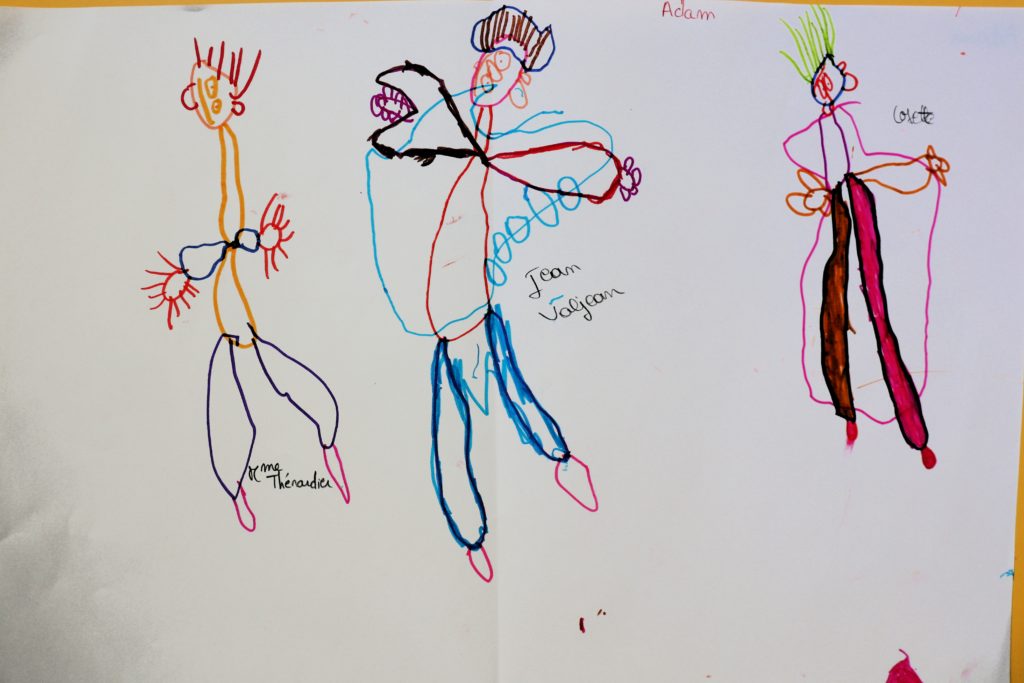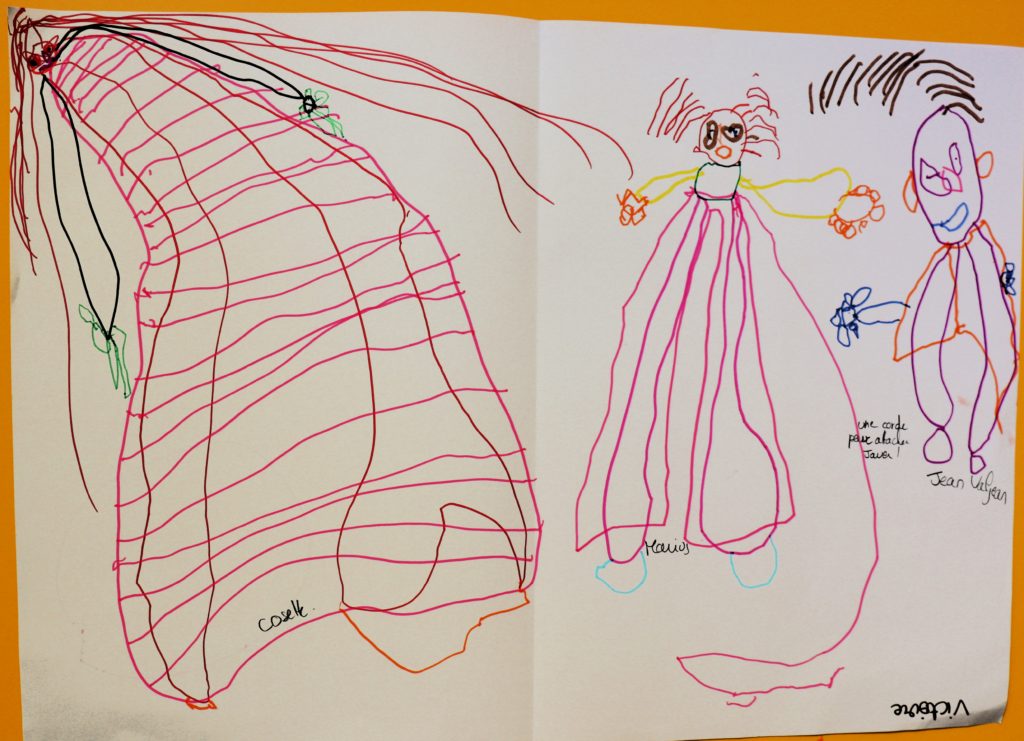Cette année nous avons choisi comme spectacle la comédie musicale « Les Misérables ».
The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (5.135.52.18) violates this restriction.La première étape était donc de raconter aux enfants l’histoire de Jean Valjean, Fantine, Cosette, Eponine, Marius et ses amis révolutionnaires. Pour comprendre leurs aventures, il fallait expliquer le contexte historique dans lequel ces personnages évoluent. Nous sommes donc remontés 200 ans auparavant : au début du 19ème siècle.
Tout commence par le vol d’un morceau de pain par Jean Valjean pour nourrir les enfants de sa sœur, ce qui le conduira au bagne. Si le héros des « Misérables » commet ce larcin c’est justement car à cette époque la misère était grande et nombreux étaient ceux qui ne mangeaient pas à leur faim. Certes, les enfants savent bien que malheureusement la pauvreté existe encore aujourd’hui (dans notre pays dit « riche »), mais dans ces années-là, se procurer de la nourriture étaient la préoccupation quotidienne de beaucoup de gens ; quand bien même ceux-ci avaient un travail. Nous avons tenté de comprendre pourquoi. Il n’existait alors aucun système de protection sociale organisé pour venir en aide aux individus confrontés à des situations difficiles. Seule la charité soumise au bon vouloir de ceux qui en font œuvre pouvait éventuellement (si vous aviez de la chance) vous apporter un peu de quoi subvenir à vos besoins. La réglementation du travail n’existait pas et celui qui vous employait décidait de façon arbitraire combien il était disposé à vous payer pour votre labeur.
Si Jean Valjean a volé un morceau de pain c’est donc en fait qu’il n’avait pas d’autre choix pour éviter que ses neveux ne meurent de faim. Ce geste ne méritait donc pas le bagne, se sont bien sûr indignés les enfants ? Le crime n’est-il pas plutôt d’accepter que des enfants n’aient pas à manger ?
Par ailleurs quand bien même il aurait commis une faute grave, le bagne est-il une bonne solution ? Les enfants sont les premiers convaincus que la punition en elle-même est déjà un concept qui ne provoque qu’un ressentiment de colère et de rancune pour celui qui la subit, alors quand elle prend la forme de la violence du bagne, il leur paraît évident que cela ne peut qu’engendrer révolte et désir de vengeance. Et en effet c’est exactement avec cette rancœur, contre la société qui s’est montrée profondément injuste envers lui que Jean Valjean ressort du bagne après 19 années.
Cette société du 19ème représentée par la figure du policier Javert était avant tout répressive : non seulement on ne cherche pas à comprendre ce qui conduit un individu à enfreindre les règles mais on est persuadés que seul la menace d’un châtiment terrible pourra l’empêcher de recommencer. En prenant exemple sur les conflits de tous les jours qui surgissent dans le cadre de nos interactions sociales, nous nous sommes interrogés sur ce qui amène une personne à réaliser une action préjudiciable à autrui. Nos réflexions nous ont conduit à penser qu’il y a toujours derrière une souffrance et que si elle n’est pas prise en compte, la personne ne peut pas de son côté concevoir le dommage qu’elle a causée. Nous nous sommes ensuite posé la question : qu’est-ce qui peut aider la personne à ne pas réitérer ? Tout d’abord, il faut que le regard des gens sur elle soit positif, c’est-à-dire que, contrairement à ce que dit Javert à Jean Valjean et ce qu’exprimeront ensuite tous ceux qu’il croisera en découvrant que c’est un ancien bagnard (avec un passeport jaune pour que tous prennent bien garde et se méfient de lui), il faut que la collectivité soit convaincue que cette personne n’a aucune intention nuisible ancrée en elle. Nous pensons aussi que deux autres principes sont essentiels : d’une part lui donner la possibilité de réparer sa faute et d’autre part que le groupe dans son ensemble puisse se remettre en question pour réfléchir avec cette personne à la façon dont, confrontée à la même situation, elle pourrait résoudre sa problématique personnelle sans porter atteinte à autrui.
Dans le contexte de l’époque, nous comprenons bien que Jean Valjean n’avait d’autre choix que de cacher sa véritable identité car la société intransigeante envers celui qui a enfreint la loi ne lui donnerait sinon aucune chance de se reconstruire une vie honnête.
Afin de comprendre ce qui poussa la pauvre Fantine à confier sa fille aux Thénardier, il fallait là encore expliquer comment était régie la société du19éme.
Il leur fallait se rendre compte tout d’abord du carcan moral qui pesait sur les individus. Il était ainsi notamment extrêmement mal perçu qu’une femme conçoive un enfant en dehors du cadre du mariage, ce qui choqua profondément les enfants pour qui la seule chose importante est que l’intention de devenir mère soit fondée sur l’amour. Malheureusement les contemporains de Fantine étaient bien moins ouverts d’esprit et pour eux, une femme comme elle était une personne de mauvaise vertu dont il fallait se méfier.
Par ailleurs, concernant l’éducation des enfants, rien n’était organisé pour permettre aux mères qui avaient besoin de travailler de faire garder leurs enfants : il n’existait ni crèche, ni école maternelle. Soit la femme pouvait compter sur l’entraide familiale, soit elle devait s’organiser pour accomplir son labeur tout en surveillant sa progéniture. Mais pour Fantine, il est inconcevable d’avoir sa petite auprès d’elle. En effet, la société au 19ème est transformée par l’industrialisation : c’est dans les usines que la main d’œuvre est de plus en plus recherchée. Or, bien que la place d’un enfant à l’usine fut tout à fait tolérée voir même recherchée par les patrons (on les exploitait pour un coût bien inférieur à celui d’un adulte) encore faut-il que le petit ouvrier soit en mesure d’effectuer une tâche utile pour la manufacture, ce qui n’était pas le cas de la pauvre petite Cosette encore trop jeune pour être rentable ! Beaucoup de tout petits enfants étaient ainsi placés en nourrice loin de leur mère qui s’exténuait à gagner quelques sous là où elle avait pu trouver un emploi.
De plus, Fantine qui aimait sa fille de tout son cœur n’avait aucun moyen de savoir le sort que le couple d’aubergistes réservait à Cosette. Le téléphone n’existait pas encore, elle ne pouvait donc pas parler à sa petite pour lui demander comment cela se passait. Elle ne pouvait pas non plus lui rendre visite, car à l’époque les distances sont longues à parcourir (pas de voiture bien sûr, un réseau ferré encore à ses balbutiements) : un trajet en diligence durait des heures si ce n’est des jours. Or le weekend n’était pas encore un concept d’actualité, les salariés n’avaient qu’un jour de congé par semaine : le dimanche. Deplus, un voyage en diligence coutait chère et Fantine préférait envoyer l’argent qu’elle touchait pour que les Thénardier s’occupent bien (espérait-elle) de sa petite.
Enfin personne à l’époque ne s’offusquait de voir une enfant travailler dans une auberge, même dans des conditions très dures. La scolarité ne sera rendue obligatoire et gratuite qu’en 1881. Quant aux châtiments corporels que Cosette endurait, là encore, cela ne choquait guerre en ces temps-là. C’était considéré comme un moyen efficace d’obtenir l’obéissance et la soumission à l’autorité incontestable de l’adulte qui se devait de formater l’enfant. La loi n’interdira officiellement les châtiments corporels dans les familles qu’en 2019 ! Vous imaginez bien que cela souleva moult discussions chez les petits.
Nous nous sommes également demandé ce que pouvaient ressentir les deux petites filles du couple d’aubergistes : Eponine et Azelma face au sort que leurs parents faisaient subir à Cosette. Etaient-elles indifférentes ? Là encore, il nous a fallu expliquer qu’à cette époque, la place de l’enfant n’avait pas du tout la même légitimité que celle de l’adulte, qui lui était supérieur. L’enfant n’avait pas le droit à la parole, on ne lui demandait pas de dire ce qu’il pensait ou ressentait. On peut donc imaginer que les filles des Thénardier n’osaient absolument pas manifester un quelconque désaccord envers l’attitude de leurs parents, de peur de s’attirer leur réprobation foudroyante. Témoins de leur violence, il valait mieux pour s’en protéger n’exprimer aucun reproche. On peut même imaginer que, pour se protéger de tout sentiment de culpabilité (inconfortable émotionnellement), il valait peut-être mieux qu’elles “conditionnent” leurs cerveaux à percevoir comme normal le comportement de leurs père et mère à l’égard de Cosette.
Avec l’arrivé de Marius dans l’histoire, nous avons parlé de ce climat révolutionnaire qui agite tout le 19ème siècle. Les enfants étaient passionnés de comprendre les soubresauts que la société française a connu depuis la révolution de 1789. Pourquoi a-t-on voulu supprimer le Roi ? pourquoi les frères du roi guillotiné (Louis XVIII puis Charles X) reprennent ensuite le pouvoir ? Pourquoi, alors que l’insurrection populaire des « 3 Glorieuses » conduit Charles X à abdiquer, c’est encore un roi (son cousin Louis Philippe 1er) qui se retrouve à la tête du pays. Nous avons expliqué ce que voulait dire une république (tant espérée par Marius et ses amis en quête de liberté et de justice sociale) par rapport à une monarchie. Les petits du haut de leur 3-4ans étaient en quête de compréhension : comment fonctionne le système des élections (et d’ailleurs pourquoi les enfants n’ont pas le droit de voter ?), quels pouvoirs possèdent le président, qui d’autre peut décider dans notre pays, quels sont les domaines sur lesquels l’Etat peut intervenir pour ériger des règles… Leurs questions fusaient de toute part !
Le coup de foudre entre Marius et Cosette nous a amené à philosopher de nombreuses fois sur le thème de l’Amour. Nous avons cherché à comprendre les différentes formes d’Amour qui peuvent exister. Celui au sein d’un couple n’est pas le même que celui entre amis. Le problème étant que les protagonistes n’ont pas forcément la même perception de leur relation. En l’espèce Eponine ressent un amour passionnel et romantique pour Marius qui la considère quant à lui comme une amie très chère. Peut-on s’empêcher d’aimer, se forcer à aimer, peut-on aimer deux personnes en même temps du même type d’amour…
Et l’amour au sein de la famille, en l’espèce entre parent et enfant ? Nous avons beaucoup échangé sur la difficulté de Jean Valjean à accepter de ne plus être la seule personne dans le cœur de Cosette. Spontanément les enfants ont parlé de leur propre ressenti à l’égard de l’amour que leur père ou mère pouvait avoir pour l’autre parent, leur(s) frère(s)et/ou sœur(s) et donc du fait de pas avoir l’exclusivité de leur affection. Ils ont précisé qu’ils avaient eux-mêmes des sources d’attachement autre que leurs parents et que cela ne diminuait pas pour autant la force de l’amour qu’ils éprouvaient pour les premiers. Ils se sont questionné sur l’évolution de leur relation avec leurs parents quand ils seraient plus grands.
Pour réellement comprendre l’histoire des Misérables, il fallait aussi comprendre la personnalité de l’auteur de ce roman fleuve de 5 tomes ! Je leur ai donc compté la vie de Victor Hugo en leur demandant de m’aider à la mettre en scène en interprétant les uns les autres les différents protagonistes de sa vie. En jouant les scènes marquantes de l’existence de Victor Hugo les enfants se sont approprié son histoire. Ils se sont aussi surtout profondément attaché à cet être qui au-delà d’être un personnage célèbre devenait avant tout un humain comme eux qui a été confronté à des situations joyeuses, comme à d’autres plus compliqués, qui a dû faire des choix et prendre position en écoutant son âme.
C’est particulièrement l’enfance de Victor Hugo qui les a intéressés et c’est en s’immisçant dans l’intimité de ce petit garçon qu’ils ont ensuite aimé découvrir le grand homme qu’il est devenu.
La mère de Victor (Sophie) après avoir donné naissance à Abel et Eugène aurait voulu une fille qu’elle aurait appelé Victorine. Mais cette déception ne fut rien en comparaison à l’a découverte de son apparence si chétive que l’accoucheur pensait qu’il ne vivrait pas longtemps ! Sa mère s’attacha particulièrement à ce petit qu’elle risquait de perdre. Elle redoublait d’attentions et s’inquiétait beaucoup pour lui d’autant plus que, alors qu’il n’avait qu’un mois, toute la famille fut contrainte de déménager de Besançon vers Marseille. J’ai expliqué combien les voyages en diligence étaient fatigants, inconfortables (surtout en plein hiver) et même dangereux (accidents sur des routes chaotiques, attaques par des bandits de grands chemin). Bien que le petit Victor résista à ce trajet périlleux sa vie se compliqua encore. Alors qu’il n’avait que 9 mois, sa mère quitta Marseille, le laissant seul avec son père et ses deux frères. En effet son père (Leopold) militaire dans l’armée avait été muté à Marseille à la suite d’une querelle avec son supérieur, provoquant sa disgrâce. Afin d’obtenir un avancement c’est Léopold (contraint de rester au poste où il avait été affecté) qui envoya son épouse à Paris plaider sa cause auprès d’un de ses amis militaire (le général Lahorie). Mais Sophie mettra beaucoup de temps avant de rejoindre ses enfants et son mari car elle tomba amoureuse de Lahorie. Victor ne la revit que lorsqu’il eu presque deux ans. Malheureusement, il ne profitera que quelques mois de l’entourage de ses deux parents. Très vite sa mère décida de rejoindre son amant à Paris ; mais cette fois-ci, en emmenant avec elle ses fils. Victor fut donc ensuite séparé de son père !
L’enfance de Victor sera rythmée par les épisodes de retrouvailles houleuses de ses parents rapidement suivies de séparations.
Il verra peu son père et grandira essentiellement auprès de sa mère, ses frères et le fameux général Lahorie. Ce dernier lui témoignait une sincère affection et lui enseignait énormément de choses, ce qui comblait de plaisir le petit garçon curieux de tout qui aimait tant apprendre. Lorsqu’ils habitaient l’ancien couvent de la rue des Feuillantines avec son fameux jardin où Victor passait des heures à jouer avec ses frères et la petite voisine : Adèle Foucher (dont il était très épris), le bonheur semblait parfait.
Malheureusement, tout s’effondra pour lui quand Lahorie fut arrêté en tant qu’opposant politique à Napoléon. Sa mère désespérée décida de rejoindre son époux, qui avait lui, réussit à s’attirer les faveurs de Napoléon et occupait un poste prestigieux à Madrid où il habitait un luxueux palais. Mais ce dernier qui vivait désormais très heureux avec une délicieuse compagne n’avait aucune envie d’accueillir sous son toit sa femme Sophie. Il demanda donc le divorce. Mais ce qui choqua surtout les petits, c’est qu’il décida de mettre ses fils en pension. Victor qui n’avait pas alors 9 ans souffrit beaucoup d’être séparé de sa mère et enfermé dans cette pension où il se sentait en prison, lui qui avait toujours été libre (il n’était jamais allé à l’école, avait grandi jusque-là sans véritables contraintes).
Les enfants furent réellement soulagés d’apprendre que leur mère parvint tout de même au bout d’un an à les faire revenir en France où Victor retrouvât sa chère Adèle.
Mais le bonheur ne dura pas et lorsqu’il eut 12ans, un commissaire de police vint à la demande de son père l’arracher de nouveau à sa mère pour le confier à sa tante. Son père exigea ensuite qu’il soit mis en pension avec ordre au directeur d’empêcher sa mère de le voir. Quelle violence ! Victor passera son adolescence très malheureux dans cette pension. Il ne trouvera de réconfort que dans la lecture et l’écriture de poèmes. Sa voie était trouvée il serait écrivain.
Dès la fin de ses études, il s’empressa d’aller retrouver la belle Adèle. Mais sa mère n’était pas prête à partager l’amour de son fils et lui fit promettre d’arrêter de la voir et de lui écrire. Peu de temps après, sa chère maman mourut brutalement et Victor, dévasté de chagrin n’eut pour seule consolation que de pouvoir enfin demander la main de sa bien-aimée à ses parents. Mais rien n’est simple, et ceux-ci, inquiets que le travail de Victor ne lui permette pas de gagner suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins d’une famille, firent retarder ce projet marital. Heureusement les écrits de Victor remportèrent rapidement un grand succès. Victor épousera donc Adèle avec qui il aura le bonheur d’avoir quatre enfants.
Victor Hugo se sert de ses écrits pour défendre ses convictions. Les enfants aiment le caractère engagé de cet homme, qui utilise sa plume comme une arme pour combattre les injustices. A travers ses textes il veut tenter de rallier ses lecteurs aux causes qui lui sont chères pour tenter de bâtir une société plus équitable, où les plus faibles ne sont pas écrasés par les puissants. Les enfants qui partagent les valeurs de leur ami Victor, furent contents de savoir qu’il était une personnalité que l’on écoutait avec passion et respect.
En revanche les petits loups furent désolés que je leur annonce que deux grands malheurs frappèrent encore leur “camarade” à qui tout semblait enfin sourire.
D’un part, la mort de sa fille ainée Léopoldine ; quelque temps à peine après son mariage, lors d’une sortie en barque. Les enfants me réclamaient souvent les poèmes des Contemplations dans lesquels Victor Hugo évoque sa tendre Léopoldine.
D’autre part, son exil forcé à Jersey et Guernesey, en raison de son engagement politique contre le nouveau pouvoir en place, qui durera 19 années (comme la peine d’un certain Valjean au bagne).
Les enfants furent néanmoins satisfaits d’apprendre qu’à son retour en France, Victor fut accueilli comme un héros. Ses idées avaient continué d’irradier les cœurs des Français malgré l’éloignement. Tout comme, par-delà sa mort, les sensibilités diffusées dans ses textes, continueront de faire vibrer les esprits.
La vie de Victor Hugo a continué d’émouvoir les petits jusqu’à la fin. Ils se sont imaginé la peine du vieil homme qui verra disparaître avant lui les deux femmes de sa vie : sa femme Adèle (qui, malgré leurs relations extra conjugales à tous deux, l’a toujours soutenu fidèlement) et son grand amour Juliette Drouet. Ils seront aussi particulièrement attristés d’apprendre que ses deux fils mourront (chose totalement contre nature) avant lui. Mais ont été très touchés de découvrir la joie qu’il a éprouvé à s’occuper des deux jeunes orphelins laissés par son fils Charles : le petit Georges (3 ans) et la petite Jeanne (2 ans). Ils ont adoré la façon dont Victor Hugo parle dans son livre « l’art d’être grand père » le tendre lien qu’il a noué avec ces chers petits qui l’appellent affectueusement : « pas-papa ».